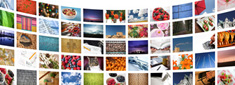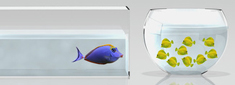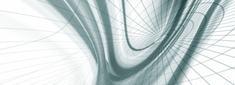Difficulté de lecture : 3 / 5
Communication et politiques
En cette année de campagne présidentielle, nous assistons à nouveau à une démonstration de stratégies communicantes par les différents acteurs politiques : tentons donc d’en comprendre quelques rouages.
Le journalisme : une évolution vers l’immédiateté
Société de consommation oblige, les médias sont désormais enfermés, plus ou moins volontairement, dans le piège du sensationnel : produire toujours plus d’émotions fortes chez le lecteur, tout en donnant le sentiment aux français de contrôler leur environnement.
Réactivité et sensation sont ainsi devenues les maîtres-mots des médias au détriment, bien sûr, des enquêtes approfondies, des explications et des débats d’idées, lesquelles par principe, prennent du temps et nécessitent une mobilisation de l’attention et de la concentration.
Les informations sont ainsi réduites aux aspects ‘faits divers’ : une juxtaposition d’évènements sans analyse, sans tentative de compréhension et donc sans confrontation d’idées. L’appauvrissement des débats est inévitable puisque d’une part, l’injonction de réactivité aboutit à une uniformisation de l’information et que d’autre part, on ne considère plus que la réaction immédiate à l’évènement en question sans passer par l’étape ‘analyse’.
La mobilisation des ‘experts’
Statisticien, analyste, sociologue, psychologue, psychiatre… les ‘experts’ sont de plus en plus nombreux à être convoqués par les journalistes et les politiques afin d’apporter leurs éclairages sur les plateaux télé. Eclairages est sans doute un terme abusif dans la mesure où, en acceptant d’endosser le statut d’expert, ils entrent dans le rôle de juge plutôt que dans celui de conseiller, et sont ainsi souvent réduits à infirmer ou confirmer les propos des uns ou des autres : action – réaction, exit à nouveau les interrogations sur la validité du raisonnement et même de la méthode (il suffit de se pencher sur les façons dont sont produites les ‘statistiques’ sur la délinquance pour s’en convaincre - 1).
De par la légitimité scientifique que leur titre leur confère, ces experts apportent leur caution au discours politique, légitiment ainsi les raccourcis sciemment élaborés et transforment des faits divers en phénomènes de société.
Ils viennent également combler la carence d’analyse et de réflexion qu’un grand nombre de journalistes ne parvient plus à réaliser de par leurs conditions de travail transformées par la tyrannie de l’audimat.
La confusion des signifiés
Les politiques sont, par essence, des orateurs. Ils manipulent et exploitent les résonances du langage au travers des associations, des représentations et des couples signifiant-signifié (2).
Nicolas Sarkozy donna un très bel exemple de cette confusion en prononçant cette phrase à propos de la situation critique dans les banlieues: « À trop vouloir expliquer l'inexplicable, on finit par excuser l'inexcusable. » Ce discours se base en effet sur la manipulation de deux signifiants du verbe comprendre ; défini comme le fait d’analyser et de rechercher les causes versus défini comme être en empathie.
La manipulation est manifeste car il porte ainsi un jugement moral et non raisonné, sur la démarche scientifique (consistant à étudier), comme si le fait d’user de son intellect était répréhensible… une association fort dévastatrice pour tout acteur qui serait tenté d’expliquer des phénomènes qui seraient jugés négativement par les français.
(1) Pour aller plus loin : L. Mucchielli, L’invention de la violence : des peurs, des chiffres, des faits, Ed° Fayard, 2011
(2) Le signifiant est la forme concrète d’un signe, le signifié, ce à quoi il renvoie.