Institutions : confiance raisonnée ou attachement affectif ?
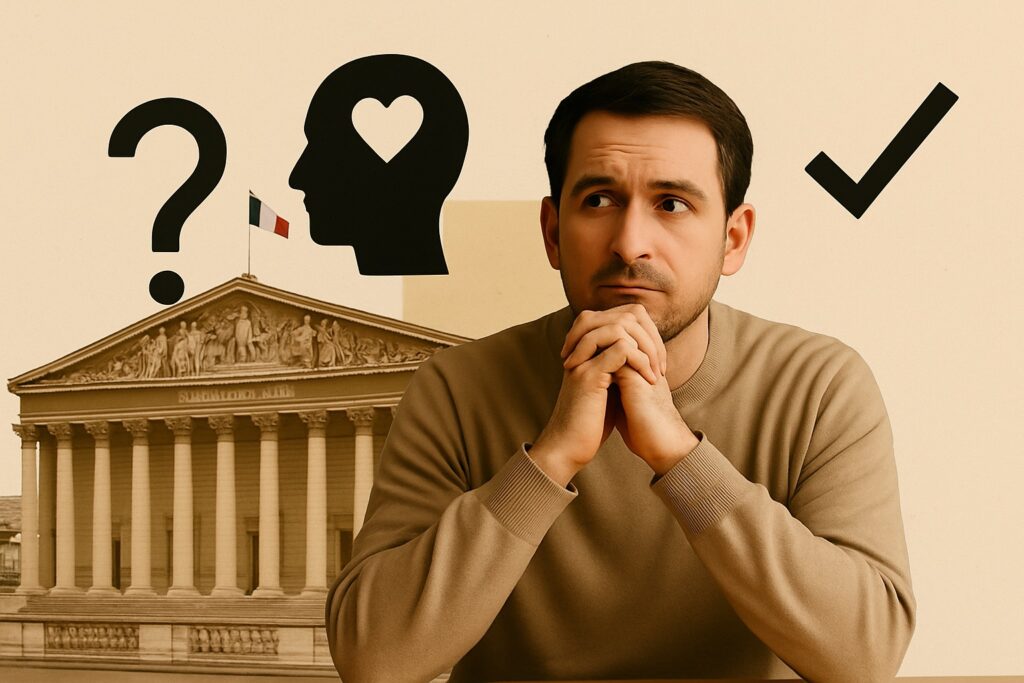
Croire en la justice, respecter les décisions politiques, accepter l’autorité médicale ou administrative : la confiance envers les institutions semble être un acte rationnel, nourri d’observation, d’analyse, de preuves. Mais en profondeur, elle touche à bien plus que cela. Et si, derrière cette adhésion apparente, se jouait un lien affectif plus archaïque, hérité, parfois inconscient ?
Un rapport au pouvoir enraciné dans l’enfance
La manière dont chacun·e perçoit l’autorité institutionnelle se construit bien avant le premier bulletin de vote. Elle dépend du rapport initial à la loi, au cadre, au tiers symbolique. Un État juste ou injuste, une école protectrice ou humiliante, un médecin qui écoute ou méprise : autant de figures qui rejouent, à un niveau collectif, la scène de l’autorité vécue dans l’enfance. Faire confiance ne relève donc pas seulement d’un calcul, mais d’un imaginaire construit. L’institution devient une figure : tutélaire, menaçante ou absente.
Une confiance transférée
Dans les périodes de crise, ce lien s’intensifie. L’attente envers les institutions devient presque affective : on espère qu’elles rassurent, qu’elles protègent, qu’elles tiennent bon. Mais lorsque cette attente devient absolue, elle excède la fonction institutionnelle. On projette sur le système un besoin de constance, de cohérence, de vérité — comme on l’attendrait d’un parent. La déception, alors, n’est pas seulement politique : elle est existentielle. Elle touche à la sécurité intérieure, à la place dans le monde.
L’adhésion, reflet d’un besoin d’ordre
Il n’est pas rare que la confiance envers une institution s’accompagne d’un soulagement subjectif : celui d’être cadré, rassuré, pris en charge. Cela ne signifie pas que cette confiance est illusoire, mais qu’elle comble parfois un besoin de structure plus profond que le simple rapport citoyen. À l’inverse, la méfiance radicale peut aussi être l’expression d’un rejet global du tiers, d’un conflit ancien avec la loi. Ce qui se joue alors, ce n’est pas seulement la politique, mais le rapport à l’altérité et à la limite.
Vers une lucidité citoyenne
Reconnaître cette dimension affective ne disqualifie pas la confiance, mais permet de mieux la comprendre. Il ne s’agit pas de refuser toute adhésion, mais de la penser : suis-je en train de croire en une institution, ou d’y projeter une attente affective ? Suis-je en train de m’informer, ou de chercher à être rassuré·e ? Cette lucidité, individuelle et collective, permet de transformer la relation au pouvoir. Elle ouvre la voie à une citoyenneté adulte, capable de soutenir ce qui fonctionne et de critiquer ce qui faillit, sans se sentir trahi·e dans l’intime.

