Le juge, figure du père ? Autorité, séparation, réparation
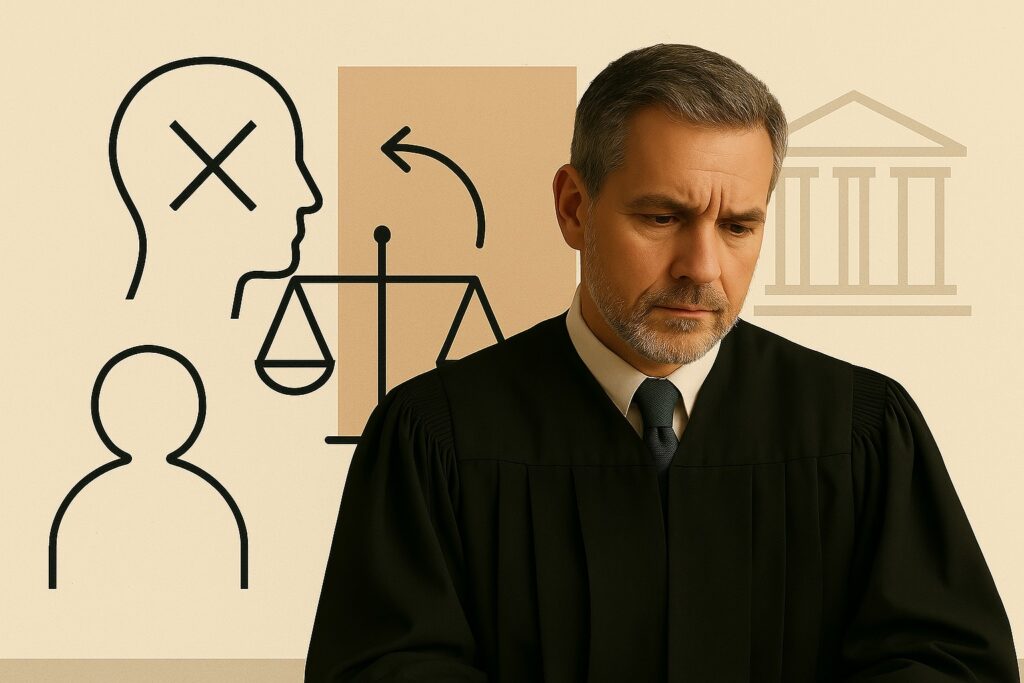
Il ne connaît pas les protagonistes, mais il les écoute. Il ne prend pas parti, mais il tranche. Le juge, dans l’imaginaire collectif, incarne bien plus qu’un professionnel du droit. Sa parole clôt les débats, organise les responsabilités, impose une limite. Cette fonction, à la fois distante et centrale, ravive un archétype profond : celui du père symbolique, dépositaire d’une loi qui ne se discute pas, mais qui fonde.
Le juge comme incarnation d’un tiers
Dans la plupart des configurations conflictuelles, ce qui manque est précisément ce tiers : quelqu’un qui, sans être impliqué, peut entendre, décider, nommer les places. Le juge apparaît alors comme cette figure neutre, mais investie. Il vient là où les parties n’arrivent plus à se parler. Son autorité n’est pas brutale, elle est institutionnelle. Mais cette autorité, dès qu’elle s’exerce, touche à une mémoire plus ancienne : celle de la séparation nécessaire, de la frustration fondatrice, du « non » structurant.
Un rôle de réparation différée
Beaucoup de justiciables ne viennent pas seulement chercher un droit, mais attendent une reconnaissance, une forme de justice symbolique. Derrière la demande, parfois disproportionnée ou confuse, il y a une blessure : d’injustice, de trahison, de déni. Le juge devient alors le garant d’une réparation que d’autres figures – parentales, conjugales, sociales – n’ont pas su ou pu apporter. Le tribunal devient un lieu où l’on rejoue l’appel au tiers, espérant que quelqu’un, enfin, dise ce qui est juste.
La loi comme séparation
Le rôle du juge n’est pas d’unir, mais de séparer. Il trace une ligne, distribue les responsabilités, rend les places distinctes. Ce geste, difficile à accepter, est pourtant essentiel. Car c’est souvent dans la confusion – des rôles, des affects, des attentes – que naît le conflit. Le juge, en rappelant la loi, réintroduit de la distance. Ce geste peut être vécu comme une violence, mais c’est aussi un acte de structuration : reconnaître que tout n’est pas réparable, mais que tout peut être nommé, encadré, limité.
Une figure à désacraliser sans disqualifier
Penser le juge comme figure du père, c’est rappeler la charge symbolique de la fonction, sans en faire un surmoi absolu. Le risque serait d’en attendre trop : une solution définitive, une guérison morale. Le juge n’est pas un thérapeute ni un parent. Il est un arbitre, un représentant du tiers collectif. Son autorité n’est pas naturelle, elle est confiée. En cela, il incarne moins une personne qu’une fonction : celle qui, dans une société, rappelle que nul ne peut être à la fois juge et partie, et que le conflit n’a pas toujours à être résolu par la force ou le silence.

