L’État et ses enfants : la citoyenneté comme dette silencieuse
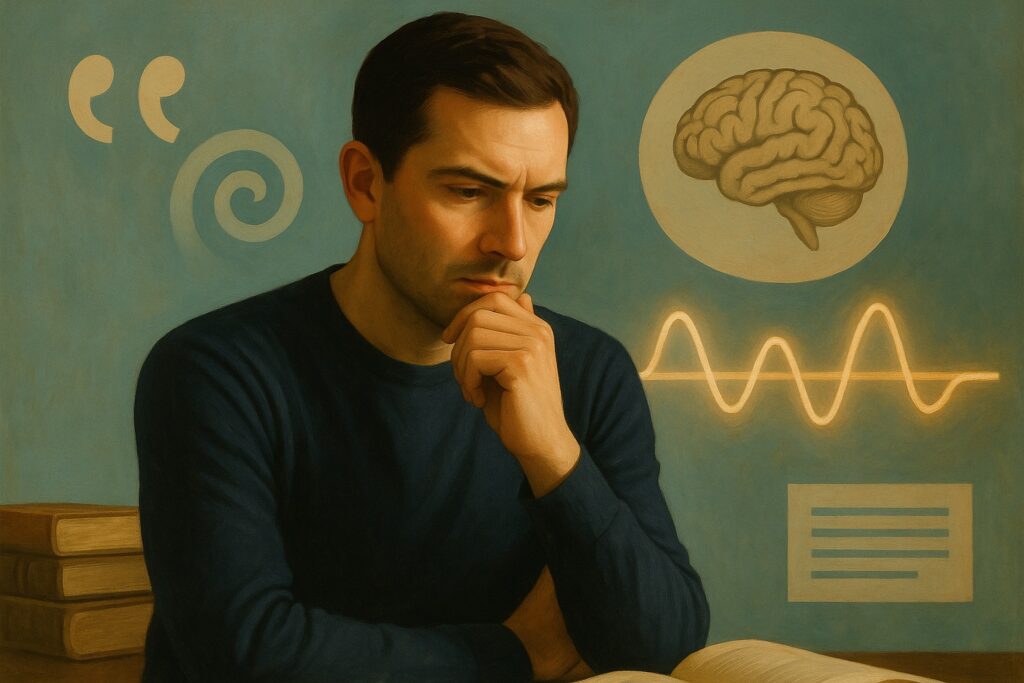
Dès l’école, on nous apprend que la République nous protège, qu’elle garantit nos droits, qu’elle est notre bien commun. Mais ce lien au politique ne repose pas seulement sur des institutions ou des textes. Il s’enracine dans un imaginaire plus profond : celui d’un État-parent, à la fois nourricier, surveillant et parfois défaillant. Ce rapport, souvent inconscient, structure une grande partie de notre vie civique : obéir, contester, attendre ou fuir deviennent des manières de rejouer cette relation première.
L’État comme figure parentale symbolique
L’État moderne, en se substituant à Dieu ou au roi, a hérité d’une fonction paternelle : il dit la loi, assure la protection, fixe les limites. Pour beaucoup, il devient une instance supérieure à laquelle on doit respect et reconnaissance. Ce rapport vertical n’est pas simplement politique : il touche à la structure psychique de l’appartenance. On ne choisit pas l’État comme un prestataire. On lui est lié par une forme de loyauté fondée sur l’éducation, les soins reçus, les droits acquis. La citoyenneté devient alors une position d’enfant symbolique : redevable, en attente, parfois infantilisée.
Une dette qui ne dit pas son nom
Il est frappant de constater combien le discours politique renvoie fréquemment à la notion de mérite, de contribution, d’effort à rendre à la nation. Ce n’est pas une simple question d’équilibre budgétaire : c’est une dynamique affective. Avoir été « aidé » par l’État crée une dette symbolique, qui peut susciter gratitude ou malaise. Ceux qui contestent l’ordre établi sont souvent accusés d’ingratitude, comme des enfants rebelles à qui l’on reproche de mordre la main qui les a nourris. Le lien civique est vécu, parfois, comme un crédit moral impossible à solder.
Entre révolte adolescente et désillusion adulte
Face à un État perçu comme froid, distant ou injuste, nombre de citoyens passent de l’idéalisation à la colère, puis à la résignation. Le sentiment d’abandon prend le relais du besoin de protection. Cette bascule est typique des relations parentales complexes : on en attendait trop, on n’a pas été entendu, on se détourne. L’abstention électorale, le repli individualiste ou les formes de radicalité politique peuvent être lus, en partie, comme des manifestations de cette désillusion. Ce n’est pas la politique qui est rejetée, c’est le lien symbolique à une autorité vécue comme défaillante.
Vers une citoyenneté adulte et autonome
Sortir de cette logique de dette silencieuse suppose de désymboliser l’État comme figure parentale toute-puissante. Il faut repenser la citoyenneté non comme un lien de filiation mais comme une co-responsabilité : ni obéissance infantile, ni rejet adolescent. Cela implique une éducation à la complexité, une parole politique moins surplombante, et des institutions plus poreuses à l’expérience vécue. Une démocratie mature ne se joue pas dans le registre de la dette, mais dans celui de la reconnaissance réciproque. L’État ne doit pas être un père idéalisé, mais un cadre partagé à réinventer.

