Un mouvement populaire pour réhabiliter le politique ?
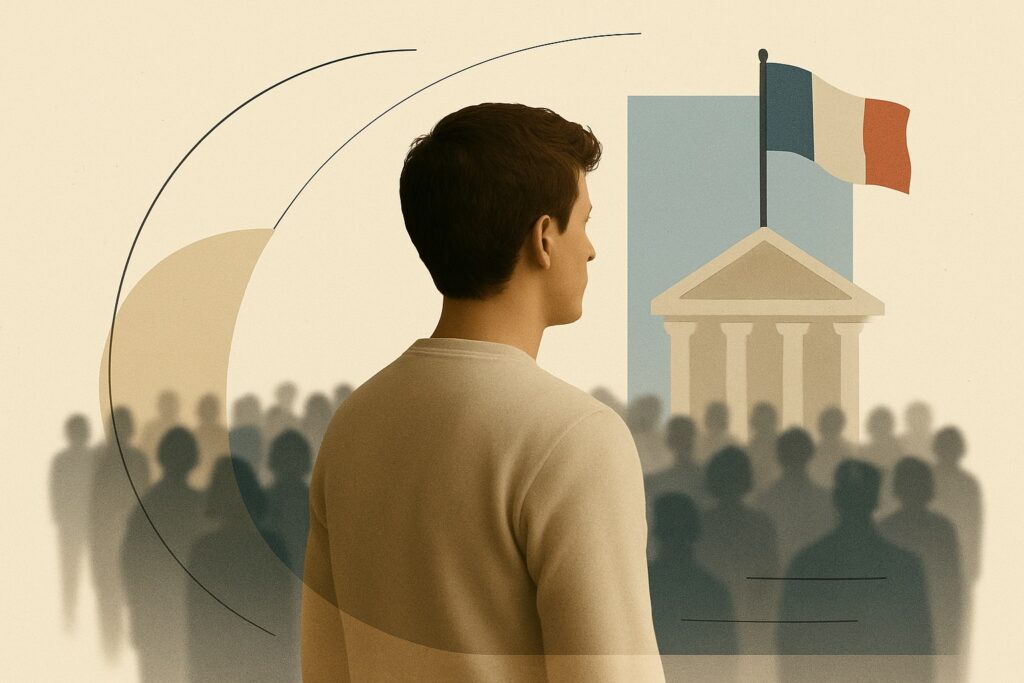
La défiance envers la politique institutionnelle s’est installée dans les esprits comme une évidence. Pourtant, derrière les critiques et les désillusions, persiste une attente silencieuse : celle de voir émerger un lien plus vivant, plus incarné, entre le pouvoir et le peuple. Et si les mouvements populaires étaient la tentative de réanimer ce lien perdu ?
Le politique vidé de sa substance
Depuis plusieurs décennies, la politique s’est professionnalisée, technicisée, éloignée. Le langage s’est aseptisé, les décisions se sont complexifiées, les figures se sont figées. Dans ce paysage, nombreux sont ceux qui ne se sentent plus représentés ni touchés. Le politique ne fait plus récit, ne fait plus chair. Il gère, il encadre, il réforme — mais il n’inspire plus. La colère populaire naît souvent de ce vide symbolique, plus que d’une seule réalité économique ou sociale. C’est moins le manque de solutions que le manque de lien qui fracture.
L’irruption du peuple comme rappel au réel
Certains mouvements populaires, spontanés, souvent décriés pour leur désordre, sont en réalité des tentatives de réappropriation de l’espace politique. Non dans sa forme institutionnelle, mais dans sa fonction symbolique : dire, contester, proposer, rêver ensemble. Les gilets jaunes, les marches pour le climat, les collectifs locaux de solidarité ou de justice témoignent de cette volonté de refaire société autrement. Dans ces mobilisations, il ne s’agit pas simplement de revendiquer. Il s’agit de réintroduire de la parole là où il n’y avait plus que des discours.
La quête de représentation incarnée
Ce que ces mouvements dénoncent implicitement, c’est l’absence de figures suffisamment humaines, suffisamment poreuses au réel, pour porter la parole collective. Ils ne demandent pas tant un chef qu’une écoute, pas tant un programme qu’une présence. Il y a là une exigence de réhabilitation du politique dans son sens premier : organiser le vivre ensemble, à partir d’une parole située, partagée, affectée. Lorsque le pouvoir ne reflète plus rien de ce que les gens vivent, ils n’ont d’autre choix que d’investir eux-mêmes l’espace symbolique abandonné.
Réhabiliter sans sacraliser
La force de ces mouvements est de rappeler que le politique ne se limite pas aux institutions. Mais leur fragilité tient à la difficulté de durer sans structure, de parler sans se diviser, de résister à l’usure. La réhabilitation du politique ne viendra sans doute ni d’en haut, ni d’une figure providentielle, mais d’une multiplication de lieux vivants, de paroles minorées, de récits concrets. Ce n’est pas une révolution spectaculaire, mais une lente reconquête du sens. Et dans cette reconquête, le politique pourrait cesser d’être un théâtre déserté pour redevenir une scène habitée.

