Le Droit est-il réservé à une élite ?
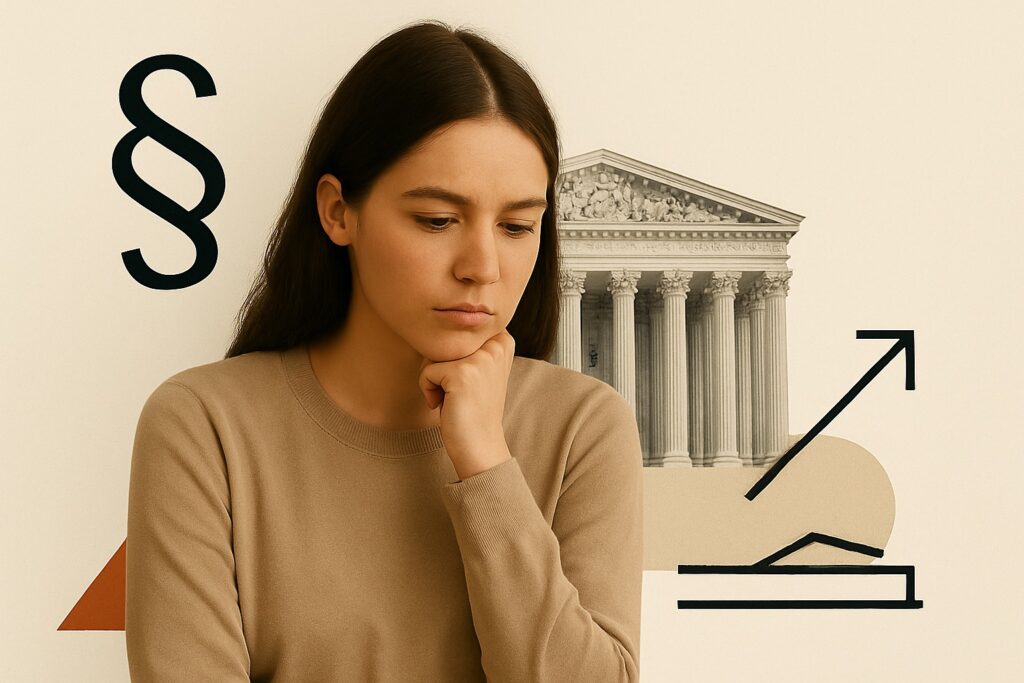
Codes, juridictions, procédures, vocabulaires spécifiques. Le droit semble parler un langage à part, complexe, parfois inaccessible. Pour beaucoup, il reste un monde extérieur, réservé à ceux qui « savent », qui « peuvent », qui « appartiennent ». Derrière cette distance, une question persiste : s’agit-il seulement d’un problème d’accessibilité ou d’un symptôme plus profond d’une fracture symbolique entre les citoyens et l’ordre juridique ?
Une langue étrangère
Le droit repose sur une rigueur, une technicité, une logique interne. Mais cette complexité, nécessaire à sa cohérence, devient rapidement opaque pour les profanes. Entre les procédures, les délais, les mots rares ou détournés de leur sens commun, l’entrée dans le droit semble exigeante, voire décourageante. Face à une assignation, un contrat, une décision, nombre de citoyens se sentent dépossédés de leur capacité à comprendre, donc à agir. Le droit devient alors un langage étranger, réservé à ceux qui ont les clés.
Un accès inégal au savoir
Cette difficulté d’accès n’est pas que symbolique. Elle se traduit par une véritable inégalité de traitement entre ceux qui peuvent se faire accompagner et ceux qui affrontent seuls l’institution. Le recours à un avocat, la lecture d’un jugement, la compréhension d’un contrat supposent non seulement du temps, mais aussi une culture, une habitude, une confiance en sa propre légitimité à « jouer le jeu ». Le droit est censé protéger tous les citoyens, mais il reste plus maniable pour ceux qui en maîtrisent les codes.
Un rapport au pouvoir dissimulé
La distance ressentie vis-à-vis du droit n’est pas seulement une affaire de vocabulaire. Elle rejoue un rapport au pouvoir plus ancien, plus affectif. Le droit incarne l’ordre, la norme, la limite. Pour ceux qui ont été confrontés à des formes d’injustice, de précarité ou d’exclusion, il peut apparaître non pas comme un allié, mais comme un prolongement d’une autorité froide, sourde, extérieure. Le sentiment d’illégitimité face au droit est souvent le reflet d’une blessure symbolique plus large : celle de ne pas se sentir partie prenante du contrat social.
Réconcilier le droit et le citoyen
Rendre le droit plus accessible, c’est plus qu’un enjeu pédagogique. C’est une manière de réintégrer chacun dans un tissu symbolique commun. Cela suppose de simplifier certains usages, de traduire sans trahir, mais aussi de redonner confiance. Le droit ne doit pas rester l’affaire d’une élite – non pas par simplification excessive, mais par réinvention du lien. Il peut redevenir un outil d’émancipation, à condition d’accepter qu’il n’est pas neutre : il parle, et il est entendu différemment selon la place que chacun occupe dans la société.

