L’ennui dans les romans comme symptôme littéraire
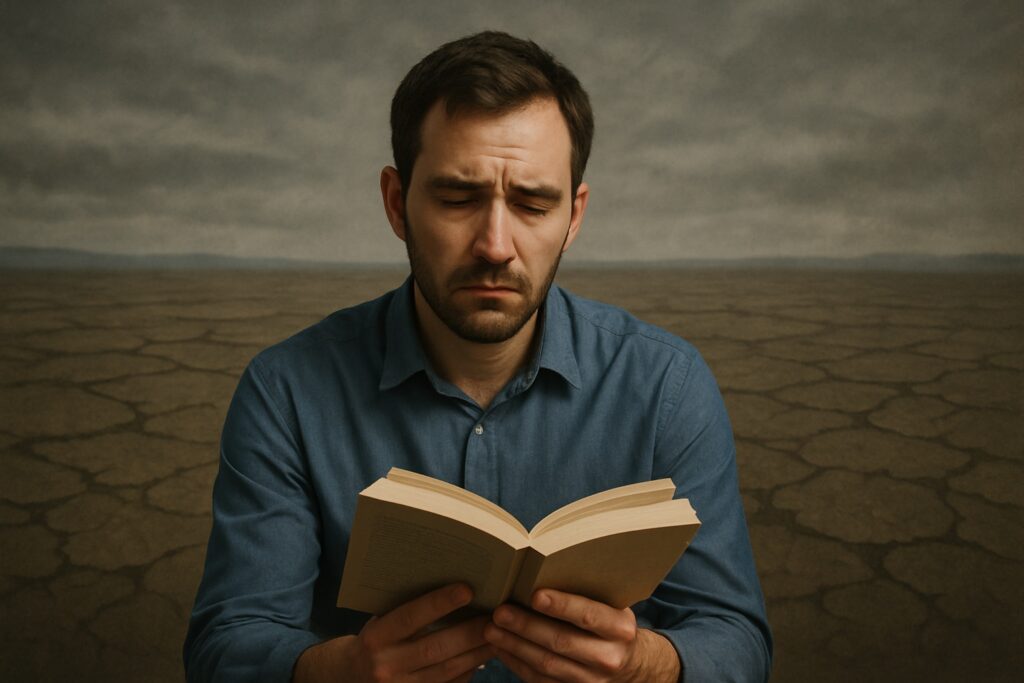
Il rôde entre les lignes, sans éclat ni drame. L’ennui, dans la littérature, est souvent considéré comme un état passager, un creux de la narration. Mais lorsqu’il devient le cœur même du récit, il révèle autre chose qu’un simple manque d’action. L’ennui existentiel, tel qu’il apparaît dans certains romans, agit comme un symptôme : non pas d’un vide extérieur, mais d’un conflit intérieur sans nom. Il traduit un refus latent, une résistance silencieuse, un désaccord profond entre le sujet et ce qu’on attend de lui. Et la fiction, en laissant s’étirer ces moments d’ennui, en fait un révélateur de ce qui ne peut pas encore être dit.
Une défense contre l’angoisse
Sous ses airs amorphes, l’ennui peut être une protection. Il sert parfois à éviter l’effondrement ou la confrontation à un réel trop menaçant. Dans les textes où il s’installe durablement, il agit comme un voile : mieux vaut s’ennuyer que de sentir ce qui fait mal ou peur. L’ennui devient alors un compromis inconscient, un entre-deux où le sujet suspend son engagement, retarde l’épreuve, se met en retrait. Ce n’est pas qu’il ne veut rien, c’est qu’il ne peut pas encore. C’est particulièrement visible dans certains romans à la première personne, où le narrateur décrit une vie sans relief, tout en laissant deviner une tension latente, une attente confuse, qui rend l’inaction signifiante.
L’ennui comme refus d’adhésion
Il peut aussi être un geste de refus : refuser de jouer le jeu, de faire semblant, de s’insérer dans un récit déjà écrit. Certains personnages, à travers leur ennui, expriment un rejet sourd du monde tel qu’il est. Ils ne crient pas, ne protestent pas, mais se désengagent intérieurement. Dans Ce que je sais de toi d’Éric Chacour (2023), l’ennui du jeune médecin dans le Caire des années 1980 ne se dit jamais comme tel, mais traverse le récit entier. Il vit, travaille, aime même, mais quelque chose en lui reste suspendu. Son apparente passivité révèle une lucidité douloureuse : il perçoit ce que la société exige, mais il ne peut ni y adhérer, ni la contester frontalement. Son ennui devient le signe d’un sujet qui perçoit l’impasse mais qui n’a pas encore trouvé de voix.
L’exemple d’Antoine, lecteur en apathie
Antoine, 46 ans, consultant en reconversion, se surprend à relire La Nausée de Sartre dans un café. Il pensait y retrouver une forme de provocation, mais c’est l’identification au malaise diffus de Roquentin qui le frappe. Comme lui, il se sent entouré d’un monde trop plein et pourtant creux. Chaque objet, chaque parole lui semble sans nécessité. Ce n’est pas une dépression, ni une révolte, mais une suspension étrange. En lisant, il comprend que son ennui n’est pas le signe d’un manque, mais celui d’un trop-plein étouffant. L’ennui agit ici comme une alerte : il signale que quelque chose cherche à émerger, mais que la forme pour l’accueillir manque encore.
Une littérature du seuil
Les récits d’ennui ne visent pas à dépeindre une fatigue banale. Ils mettent en scène un seuil, un espace d’avant. L’ennui y est une attente sans nom, un ralentissement qui prépare un basculement. Il ne s’agit pas de le résoudre, mais de l’écouter. Dans ces romans, l’ennui n’est pas le vide, c’est l’écart. Il creuse un espace intérieur que l’action ne saurait combler. En cela, il permet parfois de reconnaître des conflits profonds, des désirs enfouis, ou des refus trop anciens. La littérature, en accueillant cette temporalité flottante, offre une forme au non-encore-symbolisé. Elle fait de l’ennui non un défaut du récit, mais le lieu même où l’inconscient affleure.

