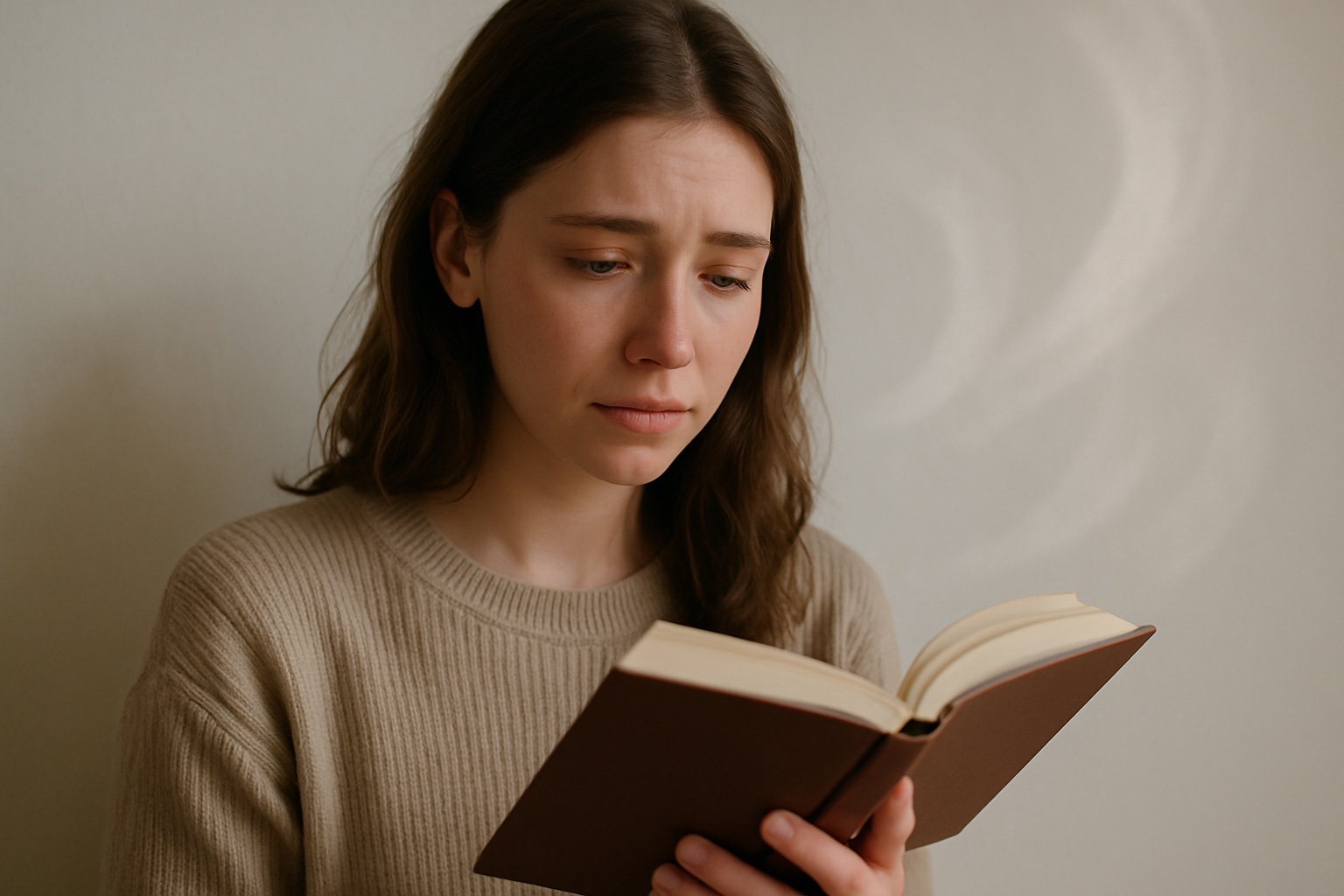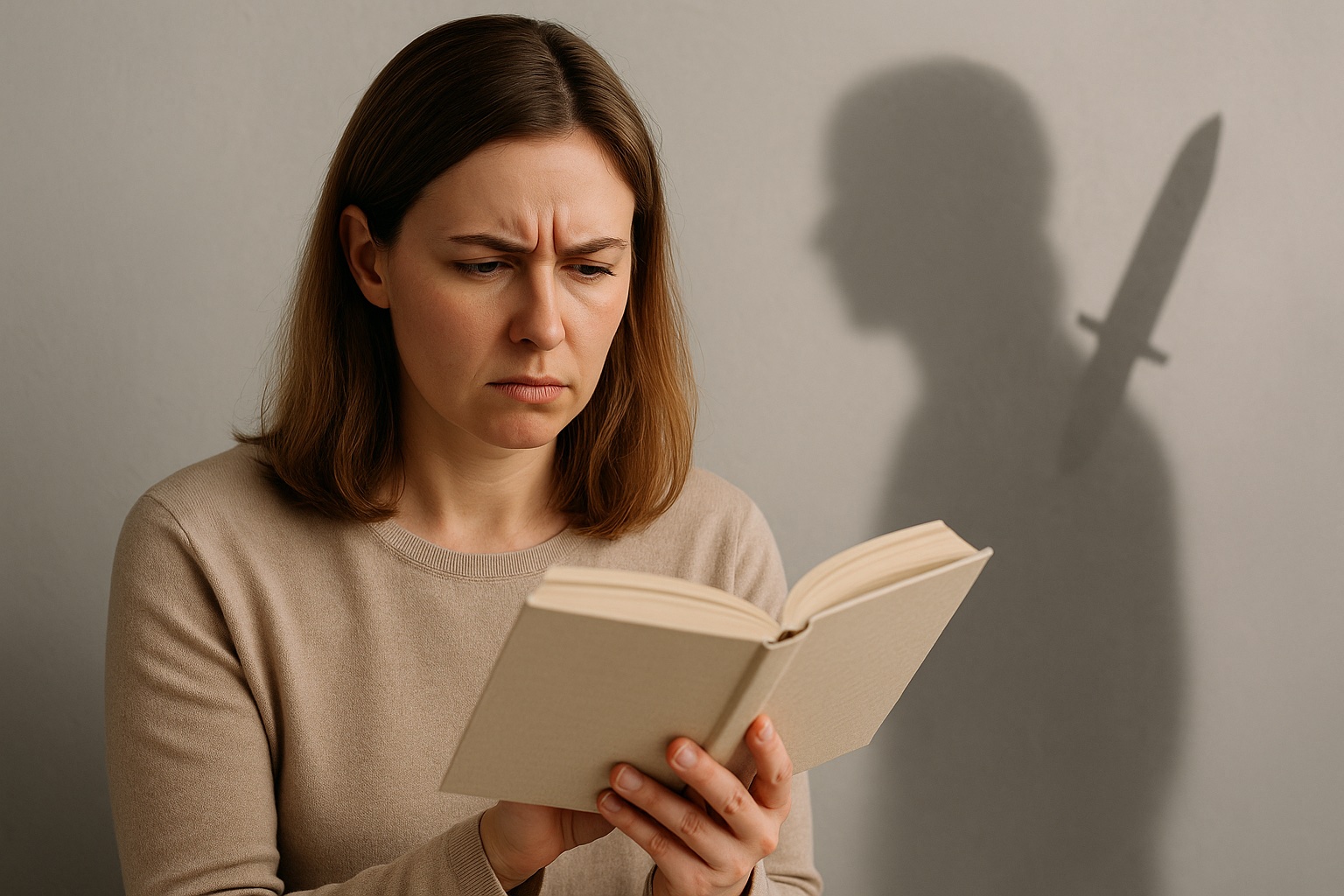Culture
Les croyances, traditions et œuvres artistiques influencent notre perception du monde et notre construction identitaire. Explorer les liens entre culture et psychologie permet de mieux comprendre l’impact des récits collectifs sur nos comportements et nos émotions.
Quand rien ne se passe : faire place au vide dans la rencontre avec l’art
Certaines œuvres nous saisissent d’emblée, d’autres nous échappent. Et puis il y a celles qui, sans être dérangeantes, laissent totalement indifférent. On les regarde, on s’en approche, mais rien ne se passe. Aucun affect, aucune pensée, aucun trouble. Ce silence intérieur est souvent vécu comme un échec, un raté esthétique. Pourtant, ce vide apparent peut être un moment important du processus de rencontre. L’absence de réaction n’est pas une fin, mais un seuil. Il dit quelque chose de la posture intérieure du regardeur. L’attente de l’effet immédiat Dans notre culture de l’impact, toute expérience semble devoir produire une émotion forte ou un savoir. Si une œuvre ne provoque ni l’un…
Trop-plein visuel : quand l’abondance d’œuvres devient étouffante
Entrer dans une exposition, c’est souvent espérer s’ouvrir à l’émotion, à la beauté ou à la pensée. Mais parfois, à peine quelques salles parcourues, une sensation inattendue s’installe : lassitude,…
Le musée comme refuge : pourquoi certains lieux d’art nous apaisent
Il arrive que l’on pousse la porte d’un musée sans projet clair, presque par besoin physique. Une envie de calme, de retrait, de silence. Et parfois, sans s’y attendre, une…
L’archétype du double : La dualité des figures et son impact sur notre psyché
Dans de nombreuses cultures et dans l’art à travers les siècles, l’idée du double a occupé une place centrale. Qu’il s’agisse de miroirs, de figures doubles ou de représentations symétriques,…
La figure de la sorcière : quand le féminin devient menaçant à l’écran
Peu de figures traversent autant de genres cinématographiques que celle de la sorcière. Présence récurrente dans les contes, les films fantastiques, les récits initiatiques ou horrifiques, elle cristallise des peurs profondes. Mais ce qui fascine dans cette image n’est pas seulement sa puissance occulte : c’est sa manière d’incarner un féminin perçu comme inquiétant, transgressif, hors norme. À travers la sorcière, le cinéma donne corps à des angoisses inconscientes liées au féminin non maîtrisable. Derrière les sorts et les grimoires, c’est une peur archaïque du pouvoir féminin qui se rejoue. Le féminin non contrôlé La sorcière dérange car elle incarne un féminin échappant aux cadres traditionnels. Elle vit seule, possède…
S’attacher aux « méchants » : quand le cinéma sollicite nos pulsions interdites
Pourquoi tant de spectateurs ressentent-ils une fascination persistante pour les personnages les plus transgressifs du cinéma ? Pourquoi admire-t-on un gangster, un meurtrier charismatique, un manipulateur froid, alors même qu’on désapprouve leurs actes ? Cette ambiguïté n’est pas le fruit du hasard. Le cinéma sait…
Le corps des acteurs : comment le geste déplace le sens
Au cinéma, tout ne passe pas par les mots. L’image prime, et le corps des acteurs en devient le premier vecteur. Un mouvement de main, un regard détourné, une hésitation imperceptible peuvent dire davantage qu’une réplique entière. Le geste, souvent involontaire ou minimal, déplace le…
L’ellipse : ce que le hors-champ nous fait éprouver
Parmi les procédés les plus subtils du cinéma, l’ellipse occupe une place singulière. En choisissant de ne pas tout montrer, le réalisateur convoque puissamment l’imaginaire du spectateur. Une scène coupée, un geste interrompu, un événement laissé hors champ ouvrent un espace où l’inconscient s’engouffre. Ce…
L’illusion de contrôle : jouer pour tout maîtriser
Certains jeux vidéo fascinent par leur complexité, leur précision, leur logique implacable. Gestion, stratégie, simulation : tout y est réglé, contrôlable, compréhensible. Pour de nombreux joueurs, cet univers constitue une…
S’énerver contre l’autre en jouant : une colère à décrypter
Le jeu est un espace supposé léger, voire joyeux. Mais il arrive que l’irritation prenne le dessus, que des remarques cinglantes fusent, que des silences se chargent de tension. Certaines…
Jeux vidéo : accumuler les victoires pour réparer une faille
Certaines personnes jouent pour explorer, d’autres pour se détendre. Mais il est un usage plus insidieux : celui de l’accumulation frénétique de victoires, de trophées, de niveaux, comme si chaque…
Ces jeux vidéo qui nous donnent envie de rester devant sans jouer
Il existe des jeux dans lesquels on cesse de « faire », mais où l’on reste, immobile, attentif, absorbé. Aucun objectif, aucune mission, aucun enjeu immédiat. Et pourtant, on ne…
La mémoire des figures parentales dans le récit littéraire
Dans les récits d’enfance, les figures parentales occupent une place centrale, mais toujours instable. Elles apparaissent tour à tour idéalisées, déformées, accusées, parfois effacées. Ce que la littérature nous donne…
L’angoisse sans cause : quand la littérature capte l’indicible
Certaines œuvres nous frappent par leur atmosphère plus que par leur intrigue. Il ne s’y passe rien de tragique, rien de spectaculaire, mais une tension sourde y règne, comme si…
Pourquoi on pleure parfois sans raison en lisant
Il nous arrive de pleurer en lisant un passage de livre sans comprendre pourquoi. Ce ne sont pas toujours les scènes les plus tragiques qui déclenchent les larmes, ni celles…
La figure du traître : miroir de nos angoisses de trahison
Peu de personnages suscitent autant de rejet viscéral que celui du traître. Il suffit d’une scène de trahison pour éveiller en nous une rage sourde, une blessure étrange, souvent disproportionnée au contexte fictif. Pourquoi ces personnages nous affectent-ils si vivement ? La figure du traître en fiction agit comme un puissant révélateur : elle réactive nos angoisses de trahison, inscrites dans notre histoire psychique. La lecture de cette figure devient alors un miroir dérangeant de nos blessures relationnelles. Un archétype chargé d’angoisses primitives La trahison met en péril l’un des fondements de la sécurité psychique : la fiabilité du lien. Le personnage de traître active ainsi des angoisses primitives liées…
Peaux à vif : la nudité comme dévoilement psychique au théâtre
Sur une scène de théâtre, le corps nu suscite souvent gêne, tension ou fascination. Mais il arrive que cette nudité…
Pièces impossibles : quand la parole échoue sur scène comme dans la vie
Il existe un théâtre du vacillement, où la parole ne parvient pas à faire lien. Ce n’est pas le silence…
La folie comme dévoilement du réel : quand l’aliéné voit plus clair que les autres
Il y a des fous qui crient, qui gesticulent, qui rient trop fort. Et puis il y a ceux qui…
Marcher en scène : une géographie affective du plateau
Un simple déplacement sur un plateau peut suffire à faire basculer une scène. Ce n’est pas tant le mouvement qui…