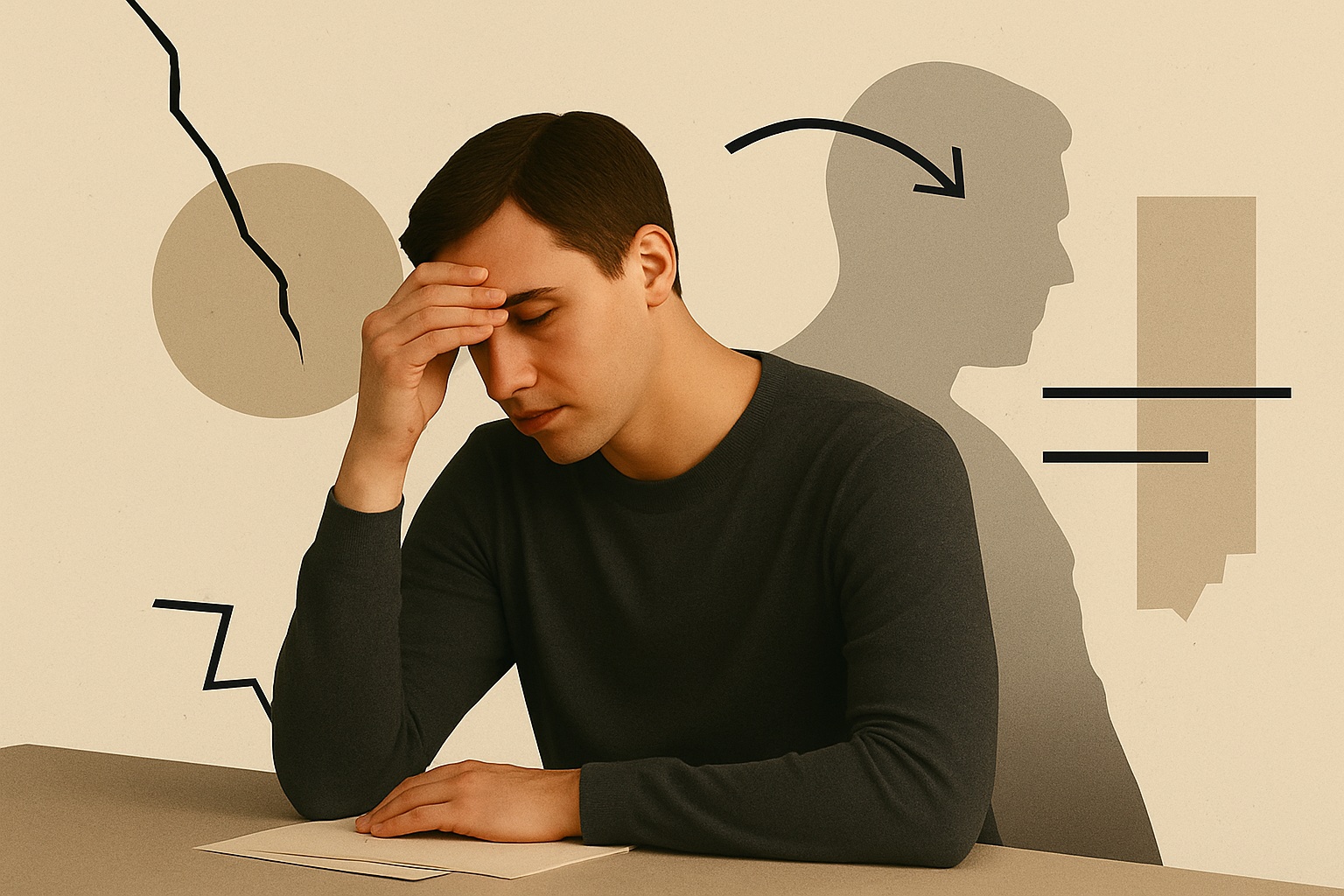Société
Nos comportements sont façonnés par notre environnement social, nos valeurs et les normes culturelles. L’influence des médias, des groupes et des institutions façonne notre identité et nos décisions. Décrypter ces mécanismes permet de mieux comprendre les dynamiques collectives et notre place dans la société.
Quand un personnage exprime ce que je ne savais pas formuler
Il arrive qu’en lisant un roman, nous soyons saisis par une phrase, un geste ou une prise de position d’un personnage. Comme si, soudain, ce qu’il exprime venait dire quelque chose que nous portions confusément en nous, sans jamais avoir su le formuler. Cette identification projective n’a rien d’anecdotique : elle révèle une rencontre entre l’univers fictionnel et des zones d’ombre de notre monde intérieur. Pourquoi certains personnages nous touchent-ils de cette façon si singulière ? Que nous apprennent-ils de nous-mêmes ? Une rencontre entre le texte et le non-dit psychique Lorsqu’un personnage vient dire ce que nous ne savions pas penser, c’est que la fiction sert de médiateur entre…
Se battre pour une cause, fuir sa propre histoire ?
L’engagement pour une cause est souvent présenté comme un signe de générosité, de courage, de clarté morale. Mais il peut aussi fonctionner comme un écran : lorsque l’énergie tournée vers…
Se former pour se sentir légitime : reconnaissance ou défense contre l’imposture ?
Il arrive que des professionnels aguerris, déjà compétents dans leur domaine, choisissent de suivre une formation qui ne leur apporte pas vraiment de nouveau savoir. Ce geste surprend de l’extérieur,…
Quand une blessure continue d’agir en silence
Il y a des événements que l’on croit rangés dans un coin de sa mémoire. On se dit que c’est derrière, que "c’est du passé". Et pourtant, quelque chose en…
Femme, homme, autre : construire sa place au-delà des rôles imposés
Être une femme, un homme, une personne non binaire ou en questionnement… autant d’identités qui, dès la naissance, sont encadrées par des rôles attendus, souvent limitants. Ces rôles de genre, visibles ou discrets, tracent des lignes invisibles : sur la façon de parler, d’aimer, de choisir, d’habiter son corps ou sa place dans la société. Mais ces cadres ne conviennent pas à tous — et parfois, ils étouffent bien plus qu’ils ne structurent. Alors comment construire sa place au-delà des rôles imposés, dans une société encore très normée ? Des rôles de genre qui précèdent l’individu Avant même de se connaître, on est déjà perçu à travers un prisme :…
Mon modèle de couple : l’empreinte de l’enfance ?
Ce que je cherche dans mes relations ne vient pas toujours de mon désir conscient. Parfois, c’est une image ancienne qui guide mes choix. Un modèle inscrit très tôt, souvent sans mots, dans la manière dont j’ai vu un parent aimer ou être aimé. Cette…
Les micro-pauses : comment le corps cherche à récupérer malgré nous
Alors que le rythme quotidien semble s’accélérer sans cesse, certains signaux corporels apparaissent sans prévenir : une baisse d’attention soudaine, un regard qui se perd, un geste qui ralentit. Ces moments, en apparence insignifiants, sont des micro-pauses que le corps impose en silence, souvent à…
Renoncer à tout porter pour commencer à exister
Dans de nombreuses équipes, certains salariés finissent par incarner une figure rassurante, structurante, polyvalente. Ils sont ceux vers qui l’on se tourne spontanément, ceux qui absorbent les urgences, qui “tiennent” quand les autres flanchent. Cette place, rarement désignée officiellement, leur confère une reconnaissance silencieuse. Mais…
Codes et coutumes de la bourgeoisie française
Souvent moquée ou fantasmée, la bourgeoisie française continue d’exister comme un univers social à part, dont les codes ne sont jamais affichés mais toujours transmis. Ce n’est pas tant une…
Quand le corps lâche le métier : le burn-out comme désaccord profond
Le burn-out n’est pas une simple fatigue. Il marque une rupture. Ce moment où le corps cesse de suivre le rythme, où il dit non à la place de l’esprit,…
L’identité sociale comme armure : entre protection et enfermement
Nous avons tou·te·s appris à répondre à la question « Tu fais quoi dans la vie ? » par une fonction, un statut ou une place. Derrière cette réponse se…
Porter l’uniforme : protection psychique ou effacement individuel ?
Porter un uniforme, ce n’est pas seulement se conformer à une exigence professionnelle. C’est aussi endosser un rôle, une posture, une image. L’uniforme fonctionne comme une seconde peau symbolique, qui…
Sortir ou rester chez soi : ce que les invitations révèlent de nous
Derrière la question apparemment banale « Est-ce que je sors ce soir ? » se jouent parfois des conflits intérieurs complexes. Il ne s’agit pas simplement de fatigue ou d’emploi…
Un poids en moi que rien n’explique vraiment
Il arrive que le corps dise ce que les mots n’arrivent pas à formuler. Une lourdeur diffuse, une fatigue persistante, une sensation de pesanteur intérieure qui résiste à toutes les…
Pourquoi certaines formations “nous appellent” sans qu’on sache pourquoi ?
Il arrive que certaines formations exercent une attraction soudaine, presque irrationnelle. Ce ne sont ni les débouchés, ni la logique du parcours qui les justifient. On ne les “choisit” pas,…
S’embrasser avec la langue, prémices de la pénétration sexuelle ?
Aucun autre préliminaire n'est aussi couramment admis que le baiser profond ou baiser avec la langue. Depuis le début de notre adolescence, aucun autre acte ne conserve sa valeur érotique originelle. Mélange des fluides, entrecroisement des corps, celui-ci nous place chaque fois dans un émoi renouvelé, intact. Quelles peuvent être les raisons de cette unanime passion pour le baiser ? La bouche, notre première zone érogène Lors de notre prime enfance, nous avons satisfait nos besoins vitaux initiaux du lait que nous avons absorbé. Cela a constitué notre bouche comme première zone corporelle pouvant nous procurer du plaisir, c'est-à-dire comme notre première zone érogène. Par la suite, la découverte…
Pourquoi la voix nous semble plus crédible que l’écrit
À l’ère de l’écrit rapide et de l’image surproduite, la voix conserve une forme de pouvoir archaïque. Quand quelqu’un parle,…
Pourquoi les médias français sont si anxiogènes ?
Le sentiment d’inquiétude permanente face à l’actualité n’est pas uniquement lié à la gravité des événements eux-mêmes. Il tient aussi…
Quand l’opinion devient produit : éditorialisation du clash
Dans un paysage médiatique saturé, capter l’attention devient un impératif économique. Or, parmi les leviers les plus efficaces, le conflit…
Ce que les séries produisent en nous : identification, projection, saturation
Les séries accompagnent nos vies avec une intensité croissante. Elles peuplent nos soirées, nos week-ends, nos moments d’échappée. On s’y…
Le langage du corps
Notre corps exprime, à lui seul, une bonne partie de ce que nous ne parvenons pas à dire avec des mots. En l’occurrence, nos douleurs et maux physiques (de ventre, de dos, de tête…) sont souvent l’expression de conflits, souffrances ou blessures en latence. De la même façon, ce que nous ne disons pas de nos désirs inconscients se retrouve, inévitablement, dans les expressions de notre corps… L’expression normale du désir Le désir humain est inhérent au principe même de vie sur terre. Motivé par la finalité que représente la sexualité, le désir (ou encore « la pulsion ») organise le fonctionnement humain et le renouvellement de l’espèce. En…
Quand l’évaluation permanente détruit la confiance en soi
Tableaux de bord, bilans individuels, objectifs chiffrés, feed-back à répétition : l’évaluation est devenue omniprésente dans le monde du travail. Présentée comme un levier de progrès, elle est censée dynamiser,…
Le collectif comme échappatoire au vide intérieur
S’engager dans un collectif, c’est souvent une manière de se relier, de partager des valeurs, de sentir que l’on agit. Mais il arrive que cette appartenance prenne une place démesurée,…
Être toujours disponible : conscience professionnelle ou besoin d’être aimé ?
Certaines personnes se rendent toujours disponibles au travail. Elles répondent à toute demande, restent tard, acceptent les imprévus sans broncher. Cette posture est souvent perçue comme de la rigueur ou…
L’éveil politique des jeunes générations : lucidité, humour et radicalité douce
On les dit désengagés, apathiques ou obsédés par leurs écrans. Pourtant, une observation plus fine révèle un phénomène inversé : les jeunes générations ne se détournent pas du politique, elles en redéfinissent les contours. Elles refusent les codes anciens, se méfient des grands récits idéologiques, mais investissent d’autres espaces — culturels, numériques, intimes — où s’inventent de nouvelles manières de penser et d’agir. Ce n’est pas l’engagement qui a disparu, c’est sa grammaire qui a changé. Un regard lucide sur les limites du système Les jeunes n’idéalisent pas la démocratie représentative. Ils la perçoivent comme imparfaite, lente, souvent hypocrite. Mais cette lucidité ne les pousse pas au cynisme, elle les…
Le rôle des médias dans la montée du populisme
La montée en puissance des figures populistes n’est pas uniquement liée aux fractures sociales ou à la défiance envers les institutions. Elle s’ancre aussi dans un écosystème médiatique qui, volontairement ou non, participe à rendre visibles, audibles et crédibles des discours simplificateurs et polarisants. Chaînes…
Populisme et mémoire collective : le passé réinventé
Le populisme ne se contente pas d’agiter le présent ou de promettre un avenir radicalement différent. Il s’enracine souvent dans une relecture du passé, un passé recomposé, idéalisé, parfois mythifié, qui sert de socle émotionnel et identitaire. Cette mobilisation sélective de la mémoire collective est…
Jouer au président : les mécanismes de surjeu et d’identification
Dans les régimes fortement présidentialisés, la fonction ne se contente pas d’être exercée : elle doit être incarnée, mise en scène, rendue visible et crédible à chaque instant. Le président n’est pas seulement un acteur politique : il est aussi un acteur tout court. Sa…
Faut-il forcément penser pareil pour vivre ensemble ?
Le vivre-ensemble est devenu un mot d’ordre. Mais derrière cette formule consensuelle se cache une question plus inconfortable : doit-on nécessairement partager les mêmes idées, les mêmes valeurs ou les…
Respect et altérité : peut-on vraiment accepter ce qui nous dérange ?
Il est facile de respecter ce qui nous ressemble. Ce qui est familier, proche, compréhensible. Mais le respect devient véritablement une épreuve lorsqu’il s’adresse à ce qui nous déstabilise, nous…
La politesse est-elle un acte de respect ou un simple code social ?
On dit bonjour, on remercie, on s’efface devant une porte. Mais que reste-t-il du sens profond de ces gestes dans un monde où tout va vite, où l’on communique par…
Peur de l’autre ou peur de soi-même ? Ce que l’altérité révèle
On croit avoir peur de l’autre, de sa langue, de ses gestes, de sa différence. Mais bien souvent, cette peur en masque une autre, plus intime, plus silencieuse : celle…