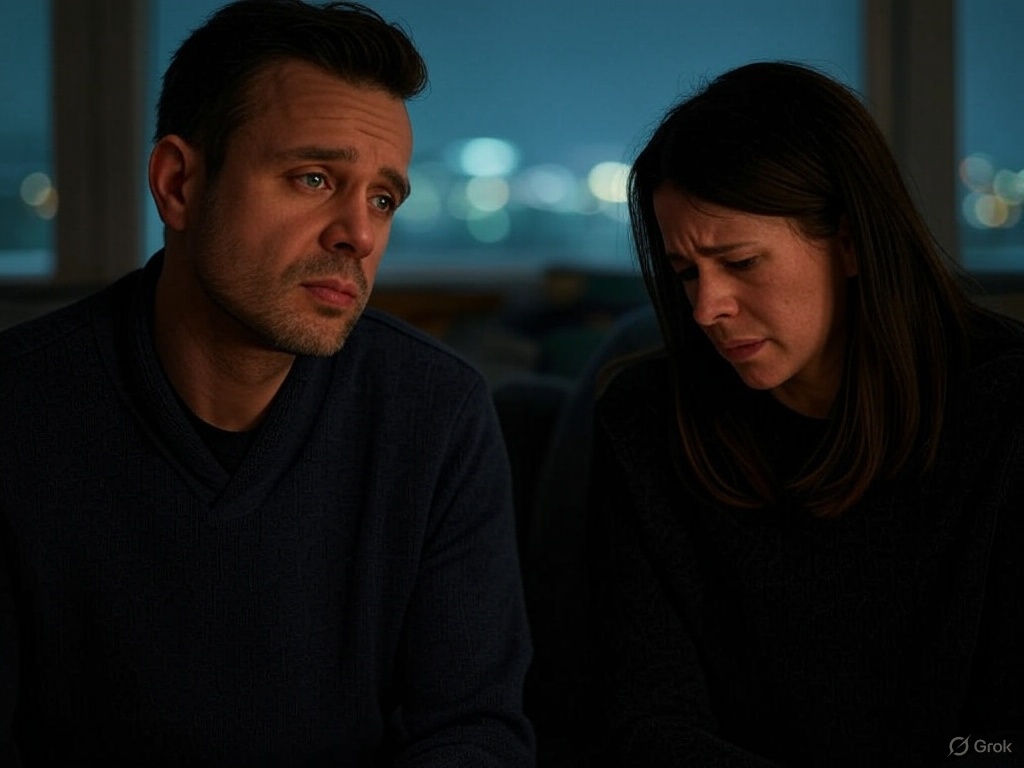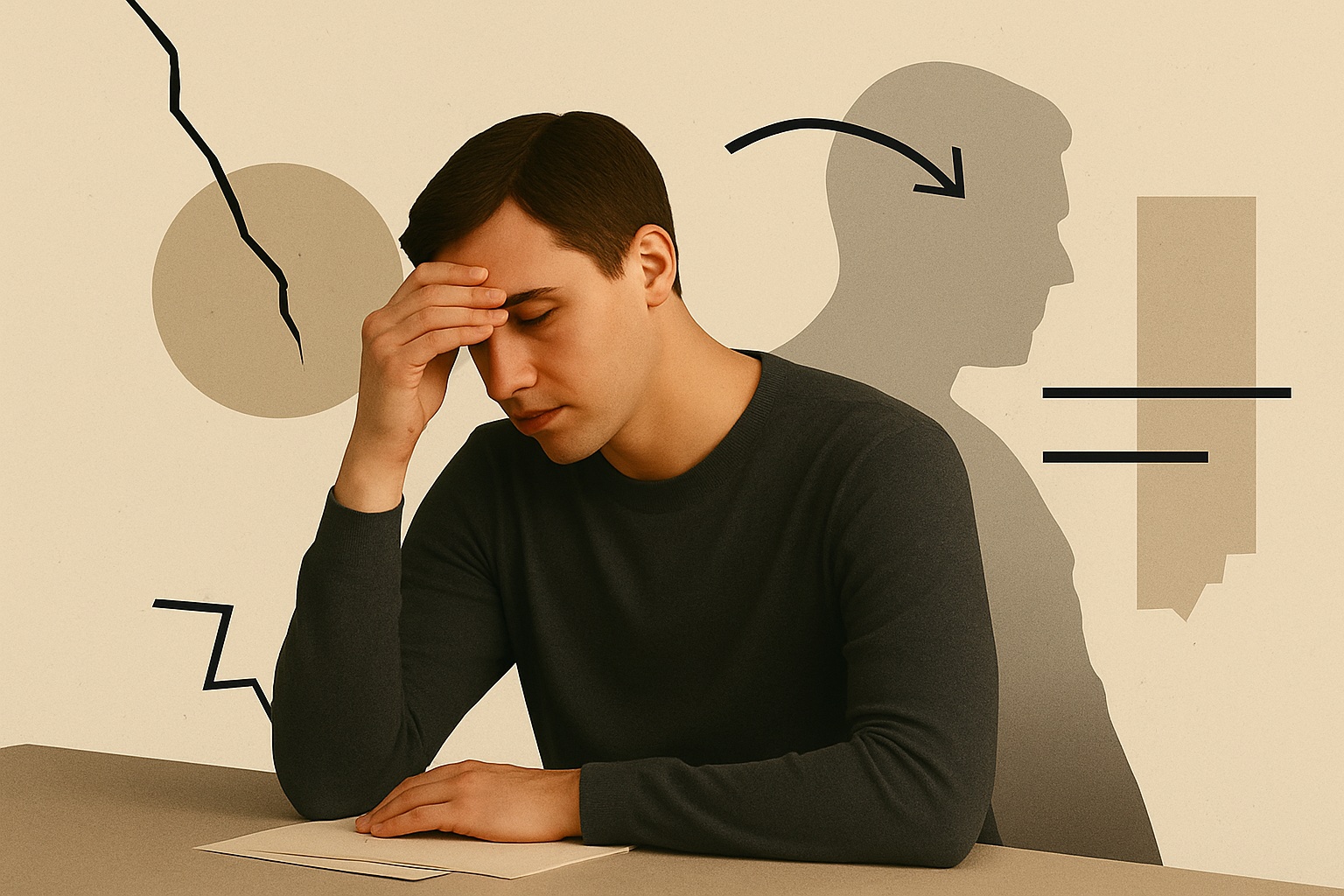Société
Nos comportements sont façonnés par notre environnement social, nos valeurs et les normes culturelles. L’influence des médias, des groupes et des institutions façonne notre identité et nos décisions. Décrypter ces mécanismes permet de mieux comprendre les dynamiques collectives et notre place dans la société.
La figure de la sorcière : quand le féminin devient menaçant à l’écran
Peu de figures traversent autant de genres cinématographiques que celle de la sorcière. Présence récurrente dans les contes, les films fantastiques, les récits initiatiques ou horrifiques, elle cristallise des peurs profondes. Mais ce qui fascine dans cette image n’est pas seulement sa puissance occulte : c’est sa manière d’incarner un féminin perçu comme inquiétant, transgressif, hors norme. À travers la sorcière, le cinéma donne corps à des angoisses inconscientes liées au féminin non maîtrisable. Derrière les sorts et les grimoires, c’est une peur archaïque du pouvoir féminin qui se rejoue. Le féminin non contrôlé La sorcière dérange car elle incarne un féminin échappant aux cadres traditionnels. Elle vit seule, possède…
Pourquoi la colère est utile
Parmi les questions fréquemment posées aux ‘psy’, celles concernant la colère sont récurrentes : « Est-ce mal d’exprimer sa colère ? Ressentir de l’agressivité est-il un aveu de faiblesse ?…
La souffrance du sujet derrière le trouble de la personnalité
On parle souvent des troubles de la personnalité à travers leurs manifestations visibles : comportements instables, relations difficiles, attitudes rigides, crises émotionnelles. Mais derrière ces symptômes se cache un sujet…
Les couleurs qui frappent : choc visuel ou mémoire affective ?
Il suffit parfois d’une couleur pour qu’une émotion surgisse. Le bleu d’un ciel sans profondeur, le rouge saturé d’un fond abstrait, un jaune presque brutal. Certaines œuvres provoquent un choc…
Comment la place familiale façonne nos choix de vie
Nous croyons souvent être les seul·es maîtres de nos choix. Pourtant, bien des décisions – professionnelles, affectives, géographiques – s’inscrivent dans des logiques invisibles, profondément liées à l’histoire familiale. Entre le désir d’émancipation et la fidélité aux siens, se joue un équilibre souvent inconscient qui influence puissamment la trajectoire de vie. La loyauté invisible : un fil discret mais solide La famille, même en l'absence de conflit manifeste, transmet des attentes implicites : ne pas faire de vagues, rester proche, réussir "mais pas trop", reproduire les valeurs du clan. Ces injonctions, rarement formulées, s’inscrivent dans des loyautés invisibles qui influencent nos élans profonds. Un enfant de parents instables cherchera parfois…
L’enfant réparateur : quand on attend qu’il comble nos blessures
Devenir parent réveille souvent des souvenirs enfouis, des manques affectifs ou des blessures anciennes. Sans en avoir conscience, certains parents investissent leur enfant d’une mission silencieuse : celle de réparer ce qui, en eux, est resté inachevé ou douloureux. L’enfant devient alors bien plus qu’un…
Supporter un manager toxique : qu’est-ce que cela dit de notre histoire ?
Certain·es salarié·es supportent pendant des mois, voire des années, des comportements de dénigrement, de pression ou de manipulation de la part de leur hiérarchie. Bien que la souffrance soit réelle, ils ne partent pas. Ils minimisent, justifient, rationalisent. On pourrait croire à un simple manque…
Avoir du mal à demander de l’aide : autonomie ou crainte de déranger ?
Certaines personnes attendent d’avoir épuisé toutes leurs ressources avant de demander un soutien. Elles préfèrent se débrouiller seules, même au prix d’un surmenage, d’une erreur ou d’un retard. Cette attitude est souvent interprétée comme une marque d’autonomie, de professionnalisme, voire de rigueur personnelle. Pourtant, elle…
Expliquer son métier : une clé pour exister socialement
À première vue, expliquer son métier semble anodin. Il s’agirait simplement de décrire ce que l’on fait, comment, et pourquoi. Pourtant, ce geste apparemment fonctionnel engage bien plus que de…
Facebook, Instagram, X et TikTok : le monde du vide ?
Ils rythment nos gestes, saturent nos écrans, façonnent nos imaginaires. Facebook, Instagram, X (ex-Twitter) et TikTok occupent une place centrale dans l’expérience contemporaine du monde. Mais plus le flux s’accélère,…
De la revendication à la rigidité : quand le mouvement devient dogme
Un mouvement naît d’une faille, d’une colère, d’un besoin de justice. Il rassemble, fédère, invente un langage. Mais avec le temps, certaines causes se figent. Ce qui était contestation vivante…
Réseaux sociaux : comment l’algorithme capte nos manques
Ce que l’on voit sur nos écrans ne résulte pas d’un hasard. Chaque image, chaque vidéo, chaque suggestion est le fruit d’un calcul. Mais derrière ce mécanisme froid se cache…
Le théâtre qui fait honte : quand une pièce révèle ce qu’on préférait ignorer
Certaines pièces ne bouleversent pas par la beauté d’un texte ou la puissance d’un jeu, mais par un sentiment plus enfoui : la honte. La honte d’avoir été aveugle, passif,…
Le monstre protecteur : figures archaïques de la sécurité et de la terreur
Certains films mettent en scène une figure ambivalente qui fascine autant qu’elle inquiète : celle du monstre protecteur. Bête puissante, créature difforme, être marginal ou surnaturel, il inspire d’abord la…
Le complexe de castration du petit garçon
Parmi les concepts les plus marquants de la psychanalyse freudienne, le complexe de castration occupe une place centrale. Notamment chez le petit garçon, il représente une étape cruciale dans la…
Croire en la France, croire en son pays
Croire en son pays : l’expression peut sembler désuète, voire inconfortable, dans une époque marquée par la défiance, les crises successives et la fragmentation du lien collectif. Et pourtant, la question du rapport à la nation ne disparaît jamais vraiment. Elle évolue, se transforme, se questionne. Croire en la France, aujourd’hui, ce n’est plus forcément croire aveuglément en ses institutions, mais peut-être croire encore à une possibilité de vivre ensemble, de se projeter, de faire société. Un rapport ambivalent hérité de l’histoire La France est un pays qui a fait de la critique une forme d’attachement. On y débat, on y conteste, on y questionne le pouvoir, souvent avec vigueur.…
Comment les médias malmènent la complexité
À l’heure de l’instantané, l’accès à une parole nuancée dans les médias grand public semble inégalement distribué. Loin de toute…
Pourquoi les médias français sont si anxiogènes ?
Le sentiment d’inquiétude permanente face à l’actualité n’est pas uniquement lié à la gravité des événements eux-mêmes. Il tient aussi…
Le pouvoir des silences à la radio : dire sans tout expliquer
À l’heure où les médias visuels saturent l’attention par l’image et le bruit, la radio, et plus encore le podcast,…
Ce que les séries produisent en nous : identification, projection, saturation
Les séries accompagnent nos vies avec une intensité croissante. Elles peuplent nos soirées, nos week-ends, nos moments d’échappée. On s’y…
Rester fonctionnaire par fidélité à un idéal parental : sécurité ou loyauté ?
Certaines personnes conservent leur poste dans la fonction publique pendant toute leur carrière, parfois sans réelle conviction, ni attachement profond à leur mission actuelle. Elles ne sont pas maltraitées, mais pas non plus nourries. Lorsqu’on les interroge sur leur choix, les réponses sont souvent pratiques : sécurité de l’emploi, stabilité, équilibre de vie. Pourtant, pour beaucoup, ces justifications recouvrent une réalité plus complexe. Derrière cette stabilité revendiquée peut se dissimuler une fidélité inconsciente à un idéal parental transmis sans mot, une loyauté profonde envers une vision du travail comme devoir et abnégation. Le poids d’un héritage invisible Dans de nombreuses familles, l’entrée dans la fonction publique représente plus qu’un simple…
Quand le corps lâche le métier : le burn-out comme désaccord profond
Le burn-out n’est pas une simple fatigue. Il marque une rupture. Ce moment où le corps cesse de suivre le rythme, où il dit non à la place de l’esprit,…
Écouter ses besoins ou ses peurs ? La confusion silencieuse du désir
On nous répète qu’il faut “écouter ses besoins”, “suivre ses envies”, “respecter son rythme”. Ces injonctions modernes, en apparence libératrices, recèlent une ambiguïté : ce que l’on prend pour un…
Statut d’indépendant : l’obligation d’assumer une position d’adulte
Travailler à son compte est souvent présenté comme une liberté : liberté d’organisation, de choix, de rythme. Mais cette liberté a un prix, parfois sous-estimé. Car derrière l’absence de hiérarchie…
Populisme et mémoire collective : le passé réinventé
Le populisme ne se contente pas d’agiter le présent ou de promettre un avenir radicalement différent. Il s’enracine souvent dans une relecture du passé, un passé recomposé, idéalisé, parfois mythifié, qui sert de socle émotionnel et identitaire. Cette mobilisation sélective de la mémoire collective est l’un de ses outils les plus puissants, car elle légitime le rejet, trace une frontière entre « eux » et « nous », et nourrit l’illusion d’un retour possible à un âge d’or. La nostalgie comme levier d’adhésion Le discours populiste fait fréquemment appel à une mémoire affective, épurée des conflits et des nuances historiques. Il ne s’agit pas d’enseigner le passé, mais de l’évoquer…
Le populisme comme symptôme d’une démocratie en souffrance
Le mot fait peur ou galvanise, selon l’angle depuis lequel on le prononce. Mais au-delà du débat idéologique, le populisme agit souvent comme un révélateur : celui d’un dérèglement démocratique plus profond que le phénomène lui-même. Derrière les slogans simplificateurs et la colère canalisée, se…
L’angoisse de castration chez l’homme providentiel
Sur la scène politique, certains hommes ne cherchent pas seulement à convaincre. Ils veulent incarner. Incarner la force, l’autorité, la sécurité. Leur posture est droite, leur voix assurée, leurs gestes calculés. Pourtant, derrière cette scénographie virile, se loge souvent une angoisse moins visible : celle…
La méfiance comme forme d’exigence démocratique
Il est devenu presque banal de ne plus croire personne. Les politiques mentent, les experts sont achetés, les journalistes dissimulent, les institutions dissimulent encore plus. Cette méfiance généralisée, souvent perçue comme un symptôme de lucidité, se présente parfois comme une forme d’exigence démocratique : le…
Fêtes nationales : un récit commun à réinventer
Chaque année, le calendrier civique est marqué par des commémorations nationales. À travers les drapeaux, les discours et les cérémonies, la société se rassemble autour d’un passé mis en forme.…
Voter, un acte de liberté et d’appartenance à la République
À l’heure où la participation électorale s’effondre, où la défiance s’installe, où l’abstention devient majoritaire, il peut sembler vain de célébrer le vote comme un acte fort. Et pourtant, voter…
Peur de l’autre ou peur de soi-même ? Ce que l’altérité révèle
On croit avoir peur de l’autre, de sa langue, de ses gestes, de sa différence. Mais bien souvent, cette peur en masque une autre, plus intime, plus silencieuse : celle…
Les fractures générationnelles : entre silence et revendications
Les générations ne parlent plus la même langue. Les uns revendiquent bruyamment, les autres se taisent avec amertume. D’un côté, la jeunesse qui dénonce, réclame, conteste. De l’autre, les aînés…